Multiperspective pour la paix
Un essai géo-poétique de Carlos Chapman.
Préambule
Les USA soutiennent le gouvernement génocidaire d’Israël et mènent des politiques étrangères calamiteuses depuis 70 ans. La Russie soutient les assassins du Hamas et mène une guerre meurtrière en Ukraine, la Chine soutient la Russie et persécute les ouighours et ne donne pas assez de libertés à ses citoyens, la Turquie soutient un autoritarisme liberticide. La France soutient le gouvernement génocidaire d’Israël (et n’est plus une démocratie depuis le 7 juillet 2024), le Royaume-Uni soutient le régime génocidaire d’Israël. Tous ces gouvernements, toutes ces institutions, provoquent en moi du dégoût de ce qu’ils font subir à nous, les peuples. Je parle bien évidemment des gouvernements et des décideurs oligarchiques, sans tous les mettre dans le même panier puisqu’il existe au sein de tous les systèmes des gens honnêtes qui cherchent sincèrement à faire progresser la paix, la démocratie, l’épanouissement et l’écologie locale et mondiale, au service des peuples et non pas des hommes les plus riches du monde.
Elon Musk se joue des peuples. Vincent Bolloré aussi, Bernard Arnaud aussi, mais ça ne sert à rien de les accuser de tous les maux. Ils façonnent les opinions publics, pour rendre acceptable le meurtre de masse. La seule chose à faire c’est que les peuples s’organisent pour des actions simultanées, coordonnées, locales, nationales et mondiales. Je ne comprends pas que ça n’existe pas. Je ne sais pas pourquoi la société civile des peuples n’arrive pas à s’organiser. J’ai une pleine confiance que la préparation de la plus grande riposte citoyenne jamais connue dans l’histoire, aura lieu au cours de ce siècle, peut-être dans moins longtemps que je ne penses. La situation géopolitique mondiale est extrêmement préoccupante, et faites bien attention à vous, car les propagandes chercheront à vous faire croire qu’il faut rejoindre un camp, il tenteront de vous faire croire que l’OTAN vous protège ou vous contrôle, que les BRICS vont sauver l’Humanité, ou la dominer, que Trump va arrêter les guerres (alors qu’il est l’affilié direct au parti de Bush le boucher d’Iraq, qu’il promouvoit tout ce qu’il y a de pire et de plus abjecte dans ce bas monde). Le grand récit mondial voudrait vous faire croire que tout ceci est une mascarade, que Trump est en réalité pour la paix. Un peu comme l’arnaque Macron-Lepen, l’un représentant le camp du « progrès », l’autre le « camp de la colère légitime ».
Nous sommes effectivement en pleine dystopie, mais j’ai une bonne nouvelle, les clés d’émancipation sont là, elles ont toujours étaient là. Il s’agit de moi, de toi, oui oui personne d’autre que toi, moi, et tous les autres, le destin de l’humanité est entre nos mains. Alors je rejoins ce camp, le seul camp que j’ai toujours choisi, celui de l’Humanité, une et indivisible.
Chapitre 1 : Souveraineté universelle pour la paix
On en est là. Au bord d’un gouffre où chaque camp politique, chaque nation, chaque bloc de pouvoir tire de son côté pour imposer sa version de la « paix ». Mais cette paix, c’est une chimère, un concept galvaudé, remodelé par les grandes puissances pour servir leurs intérêts, et on la défend les poches pleines, armées jusqu’aux dents. Voilà le tableau. Et moi, je ne peux pas être plus clair : leur vision de la paix avec des fusils, des drones tueurs, et des conseils d’administration de l’armement n’est pas la paix. Cette guerre sans fin, c’est le carburant du complexe militaro-industriel, qui se fiche de la couleur des drapeaux, pourvu que les missiles et les balles continuent de faire augmenter les tirelires.
On peut regarder les États-Unis, en première ligne, cette machine bien rodée qui, administration après administration, reste coincée dans le même cercle vicieux. Que ce soit Reagan, Bush, Obama, Trump ou Biden, tous ont continué à faire rouler cette machine de guerre. Ils la maquillent avec leurs grands discours, mais l’odeur de poudre et d’argent sale reste la même. Le soi-disant camp de la démocratie et de la liberté entretient cette paix imposée, mais une paix taillée dans la violence, sur le dos des nations qu’il prétend libérer. Et ça, c’est inacceptable.
Alors quand je parle de souveraineté, je parle de quelque chose de plus grand que ça, de plus humain. Ce n’est pas ce souverainisme étriqué, où chaque nation s’enferme derrière ses frontières en agitant des drapeaux. Non, la souveraineté que je défends, elle est universelle. Elle appartient à tous les peuples, sans distinction de couleur, de religion, de position géographique. Elle est à la planète Terre elle-même, ce morceau de poussière dans l’univers. Le souverainisme que je prône n’est pas un retour à un repli identitaire. C’est une ouverture, une reconnaissance de notre humanité partagée, de cette interdépendance qui nous lie tous, que cela nous plaise ou non.
On nous parle aujourd’hui de monde multipolaire, comme si c’était la solution miracle. C’est vrai, un monde multipolaire est une réalité qui fait plaisir, que toutes ces polarités puissent danser ensemble… Une chance de sortir du monopole des grandes puissances, de rééquilibrer les forces. Mais attention, ce n’est pas un simple jeu d’alternatives géopolitiques. Si cette multipolarité ne s’accompagne pas d’une volonté sincère de respecter les droits humains et de promouvoir une paix véritable, elle ne sera qu’une excuse pour plus de rivalité et de violence. Une multipolarité isolationniste, ou pire, expansioniste, sans valeurs appliquées, c’est simplement diviser pour mieux régner.
Et ces grandes institutions internationales alors ? L’ONU, le FMI, la CPI, l’Union Européenne, tous ces organes censés nous garantir la paix et la sécurité. Sur le papier, c’est beau, mais dans les faits, ils sont aussi englués dans des intérêts particuliers, des jeux de pouvoir. Tant qu’elles servent de terrain de jeu aux grandes puissances impérialistes en compétition, ces institutions ne pourront jamais incarner une souveraineté des peuples. Elles doivent être réinventées, purgées de cette instrumentalisation politique qui les rend complices de tant de conflits. Elles doivent être les garantes d’une paix qui vient du cœur des peuples, avec activation rapide des outils qui la favorisent.
Je ne suis pas là pour choisir un camp parmi les superpuissances, je ne suis pas là pour défendre des frontières artificielles. C’est une quête pour réconcilier les peuples avec eux-mêmes, et pour construire un monde où la paix n’est plus un slogan publicitaire, mais une réalité partagée, une responsabilité collective.
Chapitre 2 : Complexe militaro industriel mondial
Et maintenant, il est temps que je me présente. Je suis Carlos Chapman et je ne suis pas objectif, je ne suis pas neutre. J’ai des points de vue, et je vais vous les exprimer au fil de cet essai. Je n’ai absolument pas la prétention de vous cacher mes positions ; au contraire, malgré mes éventuelles illusions, je suis dans une démarche de sincérité subjective, avec une tentative d’apport au niveau du complexe monde de “l’information” en circulation. Je souhaite vous délivrer aujourd’hui un message pour la paix. Un message multiperspective qui, comme tout message, a ses limites, ses biais, et qui, je l’espère, continuera d’évoluer toute ma vie.
Mes critiques, ici, ne sont jamais dirigées contre des individus en particulier. Je vise les intérêts, les mécanismes de pouvoir, les structures qui façonnent nos réalités collectives. Est-ce que ces projets servent réellement le bien commun ? Sont-ils au service de la paix ? Mon but est de révéler, non pas des ennemis, mais des perspectives biaisées, qu’elles viennent de personnages influents ou des mouvements de pensée qui nous entourent. La question du complotisme, des dérives autoritaires, de cette crise mondiale qui prend de plus en plus l’allure d’un chaos ordonné, me fascine. Non, je ne suis pas complotiste. Mais je vois la dérive, je vois l’autoritarisme se renforcer, et je vois bien que nous sommes déjà en guerre mondiale. Le déni médiatique, lui, persiste : on nous dit que ce sont des “conflits”, des “crises”, des “tensions” qui montent. Moi, je dis qu’il suffit de regarder le bilan humain pour comprendre : 170 000 personnes décédées dans des conflits en 2023. Entre 43 000 et 180 000 morts civils tués entre 2023 et 2024 en Palestine, des conflits partout, un complexe militaro-industriel qui prospère. C’est une guerre mondiale. Tant que nous ne changerons pas ce système en profondeur, ce seront toujours les peuples qui en paieront le prix.
Alors entrons dans le vif du sujet. Parlons du complexe militaro-industriel et de la manière dont il dicte le jeu, peu importe qui tient les rênes du pouvoir. Il y a ceux qui parlent de paix, et il y a ceux qui financent les guerres. Et souvent, ils sont les mêmes. Les États-Unis en sont le modèle parfait : le même pays qui se targue d’être le protecteur de la liberté mondiale, le grand exportateur de démocratie, est aussi celui qui dépense des centaines de milliards de dollars pour des conflits à l’autre bout du monde. Que ce soit Obama, Trump, Biden… les présidents changent, la machine continue de tourner.
Le problème avec cette machine, c’est qu’elle ne s’arrête jamais. Elle alimente une industrie, des emplois, une économie tout entière basée sur le besoin perpétuel de conflits. Comment peut-on parler de paix quand chaque administration ne fait que rationaliser la violence, sous le prétexte de protéger des valeurs ? Et l’Europe, l’Union Européenne ? Elle n’est pas en reste. Elle joue souvent le rôle de soutien discret, de complice silencieux, financée en partie par les impôts de citoyens qui espèrent pourtant un monde apaisé et prospère, à l’image de l’incroyable abondance qui règne dans la nature.
Et puis il y a ce langage, ce discours savamment calculé qui présente chaque guerre comme une « intervention », chaque invasion comme un “risque de conflit régional, de guerre régionale ». Ils habillent leurs actions de mots rassurants et alarmistes à la fois, agitant la peur d’une guerre mondiale, tout en présentant ce monde (en guerre perpétuelle) comme un monde en paix, comme pour endormir la conscience collective. Mais derrière ces mots, ce sont des vies qui sont broyées, des nations entières prises en otage par les intérêts d’une minorité oligarchique et néo-féodale. Parce que, ne nous leurrons pas, derrière chaque conflit, il y a une série d’intérêts économiques, stratégiques, et politiques bien plus puissants que les idéaux affichés. Cela ne fait que renforcer dissonance et désespoir.
Alors, qu’est-ce qu’on fait avec ça ? Peut-on imaginer un monde où la paix ne serait plus la petite sœur camouflée de la guerre, où la sécurité ne serait plus synonyme de surveillance et de contrôle ? Oui, je le crois. Mais cela implique de revoir en profondeur nos alliances, nos systèmes de défense, nos façons de concevoir la sécurité internationale. Ça implique un changement radical, un désarmement mondial progressif, et une redéfinition de la sécurité. La sécurité ne devrait pas être le monopole des armes, mais celui de la coopération, de la diplomatie, du respect des droits humains.
La paix, la vraie paix, elle n’a rien à voir avec le contrôle. Elle est faite de ponts, de dialogues, de consensus apaisés et apaisants, de respect. Cette paix-là, elle n’est pas rentable, elle ne rapporte pas de contrats juteux aux industries d’armement. Mais elle est le seul chemin si l’on veut un jour sortir de ce cercle infernal qui broie des vies.
Chapitre 3 : Institutions internationales – Analyse multi perspective
Les institutions internationales. Que représentent elles vraiment ? Pour certains, elles sont des piliers de stabilité mondiale, des garants de la paix, et des plateformes pour la coopération entre nations. Pour d’autres, elles ne sont que les marionnettes des grandes puissances, des vitrines de l’impérialisme moderne masqué sous des mots rassurants. Ici, nous allons plonger dans ces institutions, les décortiquer à travers différents prismes idéologiques, et poser la question qui divise : Sont-elles au service des peuples ?
Analyse par institution et perspective idéologique
- L’Organisation des Nations Unies (ONU)
- Vue de gauche : Pour la gauche, l’ONU est souvent un symbole de diplomatie mondiale, un lieu pour défendre les droits humains et tenter de régler pacifiquement les conflits. Cependant, la gauche radicale critique fréquemment son manque d’efficacité, son alignement sur les puissances occidentales, et son incapacité à imposer des sanctions aux grandes puissances.
- Vue de droite : La droite, notamment dans sa version conservatrice, la voit comme une institution bureaucratique qui interfère dans les affaires nationales sous couvert d’humanitarisme. Pour certains, elle est un fardeau financier pour les nations et n’a que peu de résultats concrets.
- Vue souverainiste : La critique souverainiste perçoit l’ONU comme une menace à la souveraineté nationale, une entité qui impose des normes et des décisions qui ne respectent pas la volonté des peuples.
- L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
- Vue de gauche : La gauche voit souvent l’OTAN comme un bras armé des États-Unis, une alliance militaire qui sert les intérêts géopolitiques américains et qui provoque des tensions avec d’autres puissances, notamment la Russie. L’OTAN est accusée de favoriser un modèle militariste et de légitimer des interventions sous prétexte de sécurité.
- Vue de droite : Pour la droite traditionnelle, l’OTAN est indispensable pour la sécurité de l’Occident, une défense contre des « menaces globales » et un rempart contre des ennemis comme le terrorisme ou des États perçus comme autocratiques.
- Vue souverainiste : Le souverainisme critique l’OTAN comme un outil de domination américaine qui bride l’indépendance militaire des pays membres, les forçant à s’engager dans des conflits où leurs intérêts ne sont pas directement en jeu.
- L’Union Européenne (UE)
- Vue de gauche : La gauche voit l’UE comme un espace potentiel de progrès social et écologique, bien que la gauche radicale critique sa dérive néolibérale. Pour ces derniers, l’UE est trop orientée vers le marché et pas assez vers la justice sociale.
- Vue de droite : La droite traditionnelle considère l’UE comme nécessaire pour la coopération économique, mais reste méfiante quant aux normes et régulations qu’elle impose. À l’extrême droite, l’UE est perçue comme un ennemi de l’identité nationale et une menace à la souveraineté.
- Vue souverainiste : Les souverainistes la rejettent fermement, la considérant comme un levier de pouvoir pour des élites distantes de la volonté populaire. Pour eux, l’UE est une structure imposant une uniformité qui écrase les particularités culturelles et politiques des nations.
- Le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale
- Vue de gauche : La gauche voit le FMI et la Banque Mondiale comme des institutions qui imposent des politiques d’austérité et de néocolonialisme économique aux pays en développement. Ces institutions sont perçues comme instruments du capitalisme global, imposant des réformes structurelles qui profitent aux grandes entreprises au détriment des peuples locaux.
- Vue de droite : La droite considère ces institutions comme des stabilisateurs économiques nécessaires pour maintenir l’ordre mondial. Elles sont vues comme des outils permettant de prévenir les effondrements économiques.
- Vue souverainiste : Pour les souverainistes, le FMI et la Banque Mondiale exercent une pression externe qui empêche les nations de choisir librement leurs politiques économiques, les forçant à se soumettre aux conditions dictées par ces institutions.
Le paradoxe de l’universalité et des influences impérialistes
Ces institutions sont censées incarner l’unité mondiale, mais elles servent aussi, de manière tacite ou explicite, les intérêts des grandes puissances (du fait du modèle de financement de ces institutions). Cette réalité est souvent dissimulée sous le langage de la coopération, de l’aide au développement, ou de la sécurité. Pourtant, pour quiconque regarde au-delà des discours officiels, il est évident que les institutions internationales fonctionnent aussi comme des outils d’influence, permettant aux plus puissants de préserver leur hégémonie, même si c’est sous une apparence de neutralité et d’équité.
Retour aux principes fondateurs et redéfinition
Si nous voulons réellement voir ces institutions comme des vecteurs de paix, il est essentiel de revenir aux valeurs fondamentales et de les adapter aux réalités d’aujourd’hui. Une réforme en profondeur est nécessaire, où la voix des peuples prime sur celle des élites et où la souveraineté de chaque nation est respectée. Cela demande une vision audacieuse et une coopération mondiale honnête, qui ne considère plus la paix et la sécurité comme des marchandises négociables.
Il est important de souligner que, bien que des institutions comme l’ONU, le FMI ou la Banque Mondiale aient aidé de nombreux pays en développement à progresser (surtout entre 1950 et 1990), notamment en réduisant l’extrême pauvreté et en améliorant l’accès à l’éducation, la lenteur et les incohérences de ces systèmes sont aussi largement critiquées. Le discours du Premier ministre du Bhoutan lors de la soixante-dix-neuvième Assemblée des Nations Unies en septembre 2024 illustre cette dualité. Il a exprimé une gratitude réelle et sincère pour l’aide reçue, tout en soulignant l’urgence de réformer l’ONU et son Conseil de sécurité composé uniquement de cinq membre, une structure archaïque dominée par les grandes puissances, qui freine une progression plus équitable et rapide pour les nations émergentes.
Ce point de vue nuancé — qui reconnaît à la fois les contributions des institutions internationales et leurs faiblesses structurelles — est souvent absent des discours souverainistes et isolationnistes des grandes puissances, qui voient la souveraineté comme un droit exclusif et une protection contre les influences extérieures. Cette approche est différente pour des pays plus modestes, comme le Bhoutan, qui doivent composer avec des besoins d’aide internationale tout en souhaitant préserver leur autonomie. En effet, le souverainisme prend un autre sens pour des petits États : il s’agit d’une quête de résilience face aux influences des grandes puissances, plutôt que d’un nationalisme expansionniste ou protectionniste. En ce sens, le souverainisme de ces pays n’est pas une affirmation de puissance, mais une exigence de respect de leur identité et de leur modèle de développement.
Quant aux écologistes, il faut distinguer ceux qui se limitent aux problématiques environnementales immédiates de ceux qui adoptent une perspective écologique holistique. Ces derniers ne se contentent pas de traiter de la protection de la nature, mais englobent également des dimensions éducatives, sociales, et politiques pour imaginer un futur constructif. Ils défendent un concept de « souveraineté écologique », où chaque pays et chaque communauté a le droit de déterminer ses propres priorités de développement en fonction de son écosystème et de ses ressources locales, sans ingérence excessive des puissances économiques. Ces écologistes, dans leur vision multiperspective, remettent en question les modèles de développement mondiaux qui imposent des solutions standardisées et souvent destructrices pour les diversités culturelles et naturelles locales.
Chapitre 4 : La mosaïque des souverainismes et les nuances de la souveraineté
On a déjà bien déblayé le terrain : la paix, la guerre, la puissance des grandes institutions. Maintenant, on va plonger dans un autre labyrinthe, celui des souverainismes. La souveraineté. Elle peut porter des visages multiples, des définitions qui dépendent autant des valeurs que des ambitions de ceux qui la revendiquent.
Quand le souverainisme des grandes puissances rime avec domination égoïste
Dans les grandes puissances, le souverainisme est souvent une revendication d’autorité, de capacité à dicter les règles du jeu, tant pour elles-mêmes que pour les autres. Pour des figures comme Trump aux États-Unis ou certaines franges de la droite européenne, la souveraineté, c’est une arme, un moyen de faire valoir leurs intérêts sans entrave, de réaffirmer leur puissance et de dire à voix haute : « Nous n’avons besoin de personne ». Derrière ce discours, on trouve souvent la notion d’une « paix » conservatrice, une paix qui ne dérange pas les inégalités, qui ne remet pas en cause les privilèges des puissants. C’est une paix qui évite de secouer le système — à part peut-être pour donner des coups aux faibles, histoire de leur rappeler leur place.
Mais voilà le piège : quand on est un géant, souverainiste, ça peut facilement rimer avec impérialiste. L’ombre de la domination est toujours là, planant, prête à rappeler que « mon territoire » va jusqu’aux frontières que mes intérêts économiques et militaires atteignent. Alors, est-ce que c’est vraiment de la souveraineté ? Ou juste un masque ?
Souveraineté des petites nations : Résilience ou soumission ?
À l’autre bout du spectre, les petits pays, comme le Bhoutan, et bien d’autres, n’ont pas ce luxe. Leur souveraineté, elle est moins glorieuse, moins guerrière, mais tout aussi essentielle. Pour eux, la souveraineté, c’est une question de survie, de résilience. Ils n’ont pas l’ambition d’imposer leur vision du monde, mais ils veulent exister sans être étouffés par les décisions des puissants. Le Premier ministre du Bhoutan, en remerciant l’ONU pour l’aide apportée à son pays tout en critiquant l’inertie des grandes institutions, a illustré cette tension. Oui, il reconnaît les progrès réalisés grâce à l’aide internationale, mais il ne ferme pas les yeux sur la lenteur et l’incongruence d’un système qui semble fonctionner au rythme des grands, pour les grands.
C’est là toute la nuance. Pour un petit pays, la souveraineté ne veut pas dire arrogance ni isolement. Elle signifie plutôt l’indépendance d’exister à sa manière, dans le respect de ses spécificités. Ils ne veulent pas de l’indépendance au sens militaire ; ils veulent que leur voix compte, que leur existence ne soit pas une variable négligeable.
Chapitre 5 : Les illusions et les espoirs de la démocratie participative en France
Depuis les années 2010, la France (et la planète entière) a vu émerger une foule de mouvements et d’initiatives citoyennes qui voulaient bouleverser l’ordre établi. Wikileaks a sans doute largement contribué à cela, ainsi que l’algorithme “d’expansion non rentable” favorisant l’organique de Facebook). Occupy Wall Street, Indignés, Anonymous, Colibri, Nuit Debout… tous portaient l’étendard de la démocratie participative, chacun à sa manière. À l’époque, l’idée était claire : redonner aux citoyens le pouvoir de participer directement aux décisions, d’influencer réellement le cours de leur pays et de leur quotidien. Mais voilà le paradoxe : malgré cette effervescence citoyenne, malgré les millions de voix qui se sont élevées, la démocratie française, elle, reste coincée dans un cadre rigide, presque immobile.
Le réveil citoyen des années 2010
Commençons par les années 2010, cette décennie où les citoyens du monde entier semblaient décidés à bousculer les puissants. En France, les mouvements comme Anonymous et Colibri ont agi comme des catalyseurs, chacun dans un registre bien distinct.
Anonymous, ce groupe aux visages masqués de Guy Fawkes, défendait un message simple mais puissant : défendre les libertés et dénoncer les abus de pouvoir par des actions numériques. Ils attaquaient symboliquement les grandes corporations, les gouvernements qui espionnaient leur peuple, et défendaient une transparence totale. À leurs yeux, la démocratie ne pouvait plus se contenter d’élire des représentants, il fallait pouvoir remettre en question les décisions en direct, démasquer les corruptions.
Pendant ce temps, le mouvement Colibri prenait un chemin plus doux, plus local. Inspiré par Pierre Rabhi, il encourageait les Français à agir, chacun à leur échelle, pour construire une société plus écologique, plus juste. Pas de coups d’éclat, mais un appel à la transformation de la société, du bas vers le haut. C’était et c’est toujours un projet de société où chacun devient responsable, où chaque acte quotidien est un acte politique. Une révolution douce, mais une révolution tout de même.
Les limites de la démocratie française : un système verrouillé
Mais voilà, malgré cet élan, la démocratie française, elle, n’a pas beaucoup bougé. Pourquoi ? Parce que le système est verrouillé. La Cinquième République, avec son président tout-puissant et ses institutions centralisées, ne laisse pas beaucoup de place à la participation directe. L’exécutif décide, le Parlement suit, et le citoyen, lui, observe. Les tentatives de démocratie participative peinent à se concrétiser, face à cet édifice rigide, taillé pour un homme fort, un président, qui concentre le pouvoir.
Prenons un exemple qui résume ce verrouillage : le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Les Français votent non, rejetant cette Constitution. Pourtant, quelques années plus tard sous la présidence Sarkozy, par un tour de passe-passe politique, les parlementaires adoptent un texte très similaire via le Traité de Lisbonne. Ce choix, une trahison démocratique, a sapé la confiance dans les institutions. Comment croire en la démocratie participative quand la volonté populaire est ainsi contournée ? Ce référendum reste un symbole de la distance qui sépare les citoyens de leurs dirigeants, ce qui est bien dommage puisqu’une Union Européenne protégeant les droits humains, les droits des peuples, renforçant les coopérations, et permettant de faire face à une géopolitique mondiale complexe, est en soit quelque chose de très bien et constructif. Ce genre de trahisons démocratiques ne fait que ralentir l’avènement d’une fédération démocratique mondiale des peuples souverains. L’UE n’est pas un mal en soit, il s’agit de définir sa mission au service des souverainetés des peuples qui la composent.
Le mouvement des Gilets Jaunes : symptôme d’une colère sourde
Et puis, il y a eu les Gilets Jaunes. Ce mouvement, qui a explosé en 2018, n’était pas né d’une idéologie structurée ou d’une organisation centralisée. C’était une réaction spontanée, brutale, née de la colère de ceux qui se sentaient oubliés, méprisés. Pas de leaders charismatiques, pas de programme politique clair, juste un ras-le-bol général contre la précarité, les taxes, et surtout, un sentiment profond de déconnexion entre le peuple et ceux qui gouvernent.
Les Gilets Jaunes ont réclamé la démocratie participative à travers le RIC (référendum d’initiative citoyenne). Leur idée était simple : que le peuple puisse proposer et voter directement des lois, sans passer par des élus. Un moyen de contourner ce Parlement perçu comme complice du pouvoir exécutif, et de ramener le pouvoir aux mains des citoyens. Mais là encore, la réponse du pouvoir a été brutale. Plutôt que d’écouter, l’État a réagi par une répression violente, cherchant à contenir le mouvement par la force. Cette réaction a renforcé le sentiment que, malgré les grands discours, la démocratie participative reste une utopie en France. Etienne Chouard, avec l’idée du tirage au sort des élus parmi l’ensemble de la population, balayée, occultée par les grands médias. Je suis personnellement pour une solution mixte, 50% d’élus, 50% de tirés au sort).
La multiplication des voix et la confusion des idées
Ce n’est pas seulement l’État qui a freiné la démocratie participative. La montée des réseaux sociaux, la multiplication des médias alternatifs et des voix dissidentes ont engendré un autre phénomène : la propagation du confusionnisme. Face à la saturation d’informations, de contre-informations et de désinformations, il est devenu de plus en plus difficile pour les citoyens de se forger une opinion claire.
Dans cette cacophonie, des figures comme Idriss Aberkane émergent, se revendiquant de la multiperspective et de l’indépendance d’esprit. Et c’est vrai, ils apportent des points de vue différents, des critiques justifiées et enrichissantes.
Sa démarche se veut multiperspective et critique, et il s’affiche comme étant en faveur de la paix, dénonçant les conflits et les politiques guerrières, notamment des États-Unis sous l’administration Biden. Son positionnement comme “troisième voie » est intéressant, car il revendique une alternative qui, en apparence, ne se range ni dans un camp, ni dans l’autre. Cependant, lorsqu’il prend position en faveur de Trump en tant que promoteur potentiel de la paix, un paradoxe se crée.
D’un côté, il rejette la polarisation et la propagande qui divisent, mais, en optant pour une figure comme Trump, il risque d’alimenter une autre forme de propagande, même indirectement. Trump est certes perçu par certains comme moins interventionniste, notamment en ce qui concerne les guerres extérieures. Mais cela ne veut pas dire qu’il est pacifiste ou qu’il incarne une vision réellement inclusive, surtout vis-à-vis des communautés musulmanes. Le soutien que des musulmans peuvent accorder à Trump, n’est peut-être pas un signe de paix universelle, mais une convergence temporaire d’intérêts ultra-conservateurs, notamment homophobes, à travers des propagandes anti-wokisme.
C’est là que la nuance est essentielle : critiquer les actions guerrières ne suffit pas à faire de quelqu’un un véritable acteur de paix, surtout si son discours se contredit en proposant une voie de paix en soutenant le système binaire, éloignée des peuples. La paix que défendent certains conservateurs, comme Trump, est davantage une paix de « stabilité conservatrice », dans laquelle les inégalités et les tensions sont renforcées.
Alors, que reste-t-il des années 2010 ? Peut-être une leçon simple mais puissante : la démocratie participative, pour qu’elle existe réellement, doit dépasser les slogans. Elle demande des changements structurels profonds, une révision de nos institutions, et surtout une vigilance constante face aux pièges de la polarisation et de la confusion.
Chapitre 6 : La Démocratie des Peuples – Une demande mondiale pour la liberté et la dignité
2019 fut une année charnière. Dans plus de dix-huit pays à travers le monde, des foules ont envahi les rues, exprimant un ras-le-bol global, une soif de justice, de dignité, et de liberté. Les citoyens du Chili, de Hong Kong, d’Algérie, du Liban, de France avec les Gilets Jaunes, et bien d’autres, partageaient une frustration commune, bien que chaque mouvement ait ses propres causes et contextes. Que ce soit contre les inégalités économiques, la corruption, les atteintes aux droits humains, ou la rigidité de régimes politiques, tous portaient un message similaire : le besoin d’une démocratie plus participative, d’un respect accru pour les voix des peuples, et d’un espace pour la société civile.
Ces manifestations n’étaient pas centralisées ni coordonnés. Elles ne se connectaient pas, ne s’organisaient pas par-delà les frontières. Pourtant, elles semblaient toutes résonner autour d’une revendication universelle : une demande de reconnaissance et de libertés, un appel pour que la gouvernance mondiale s’aligne sur les besoins des citoyens, et non sur les intérêts d’une minorité puissante.
Mais que s’est-il passé ? Les répressions ont été vives, brutales, systématiques. Dans de nombreux pays, les manifestants ont été arrêtés, gazés, et frappés. Le message n’était pas entendu, il était étouffé. Et juste au moment où la flamme de la révolte s’allumait dans un nombre croissant de pays, la pandémie de Covid-19 est venue frapper en 2020, imposant un silence forcé.
Covid-19 : Début de la Guerre Mondiale psychologique, (dite “hybride”)
Avec le Covid-19, les répressions ont pris un nouveau visage. Le confinement, les fermetures des frontières, l’arrêt des transports internationaux, la surveillance accrue ont créé une ambiance de guerre, même si les bombes ne tombaient pas. C’était une guerre psychologique, un choc global. Partout, les individus se sont retrouvés enfermés, coupés du monde extérieur, privés de leurs libertés les plus fondamentales.
La pandémie a agi comme un verrou final sur les tentatives de changement et de participation citoyenne qui s’étaient multipliées l’année précédente. Mais bien plus encore, elle a semé un traumatisme collectif. Les confinements, la peur du virus, les pertes humaines, la saturation des systèmes de santé ont engendré des effets psychologiques profonds. Dissonance, Anxiété, dépression, sentiment d’impuissance… Tout cela a marqué les esprits et les cœurs, créant une fracture, une rupture. À mes yeux, c’était là le début de la Troisième Guerre mondiale — une guerre sans affrontement direct mais qui s’infiltre dans les esprits, qui divise les nations, les familles, et même les consciences.
Bien sûr, c’est mon interprétation, ma façon d’interpréter les évènements, qui tiennent néanmoins compte de réalités factuelles et vérifiables. D’autres pourront dire qu’il ne s’agissait « que » d’une crise sanitaire mondiale. Mais pour moi, le Covid a amplifié les tensions sociales et politiques, a révélé les failles d’un système mondialisé et interconnecté. Il a montré que, dans la lutte pour le pouvoir et le contrôle, les gouvernements étaient prêts à restreindre massivement les libertés individuelles au nom de la sécurité “sanitaire” collective. Et là encore, la question de la sincérité de ces mesures reste en suspens. Je rajouterais ici, pour essayer de bien me faire comprendre, que je n’ai aucune idée de l’origine du virus, je ne peux pas affirmer qu’il s’agit d’une pandémie volontaire, par contre je peux affirmer que la réponse politique à cette pandémie à révélé les orientations autoritaires et conservatrices du monde actuel, malgré les progrès sociaux et humains qui co-existent lorsqu’on regarde l’évolution de l’Humanité à une échelle de temps plus large.
Le confusionnisme en temps de crise : entre conspiration et répression
Dans ce climat de chaos, de crise sanitaire et de révolte, un phénomène pernicieux s’est renforcé : le confusionnisme. Des informations contradictoires circulent sans cesse. Les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux… tous semblaient diffuser des messages différents. À qui faire confiance ? Comment se faire une idée juste ?
Et c’est là qu’un nouveau danger est apparu : même les voix indépendantes, celles qui prônent la paix, l’écologie, et l’humanisme, se sont retrouvées piégées dans ce brouillard de confusion. Des figures comme Idriss Aberkane, par exemple, qui se revendiquent multiperspectives, peuvent être entraînées dans des dynamiques de polarisation sans s’en rendre compte. Parfois, même les intellectuels les plus sincères se retrouvent à relayer, consciemment ou non, des arguments biaisés, des informations teintées d’idéologies cachées. Dans cette « guerre des esprits », chaque opinion devient un potentiel champ de bataille, chaque vérité une cible.
La complexité du monde contemporain dépasse de loin les schémas simplistes. Les gens veulent des réponses, des certitudes, mais ces réponses sont teintées de biais, de parti-pris. Il devient alors crucial d’assumer son propre regard, de rappeler aux lecteurs, aux citoyens, qu’il n’y a pas de point de vue neutre. En revendiquant la multiperspective, en adoptant une approche ouverte et critique, chacun devient aussi un acteur, mais un acteur conscient des limites de sa perception.
Une dystopie moderne : entre rêve de liberté et réalité oppressante
Nous sommes en pleine dystopie, mais une dystopie contemporaine où chaque citoyen est à la fois spectateur et acteur. Il ne s’agit pas simplement d’une bataille entre le « bien » et le « mal ». Les lignes sont floues, les intentions se mêlent, et même les voix les plus sincères peuvent contribuer, sans le vouloir, à renforcer des dynamiques de contrôle et de polarisation. Il est probable que moi-même, du moins mes idées, puissent choquer, ajouter du doute ou de la dissonance à ceux qui ont cru si fort à tout cela. Mon intention est d’ouvrir les perspectives et sortir des polarisations, y compris celles dans lesquelles je tombe à mon insu.
Alors, où cela nous mène-t-il ? Ce chapitre pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Peut-être faut-il accepter que cette complexité fait partie de notre époque, que la recherche de vérité est un chemin semé d’embûches, un jeu d’équilibre constant entre vigilance et engagement. Peut-être que notre rôle n’est pas de fuir ce confusionnisme, mais de le comprendre, de l’accepter comme une dimension inévitable de notre monde complexe.
Au final, la seule chose qui demeure est la sincérité de la démarche. Pour ceux qui, comme moi, cherchent à analyser et à comprendre, il est crucial de toujours inviter les lecteurs à questionner, à remettre en question les informations (y compris les informations qui remettent en question l’information), à prendre du recul. Dans ce climat de confusion mondiale, où la vérité est fragmentée, il est essentiel de rester lucide, de ne pas céder aux simplifications.
Chapitre 7 : Moi aussi, j’ai été piégé – Entre illusions ultra-libérales et soif de sécurité
C’est ici un examen de conscience. Un exercice d’honnêteté qui débute par la reconnaissance de nos propres biais, de ces influences que l’on absorbe sans les interroger. J’ai moi-même été pris dans cette dynamique, à mon insu, et voilà que je constate aujourd’hui combien ces « logiciels mentaux » – ces filtres invisibles – ont façonné mes perceptions. Mes idéaux humanistes, multi perspectives ? Ils ont aussi été traversés, dérivés, par des valeurs que je n’avais pas consciemment choisies.
Au fil du temps, la sécurité et la réussite matérielle prennent une allure séduisante. En vieillissant, le vidéaste freelance à finit par chercher une stabilité, un ancrage, le gain matériel pour sortir de la pauvreté, se sentir riche, investir, c’est tout à fait légitime à bien des égards. Ce qui l’est moins c’est l’égoïsme : Les valeurs de performance, d’hyper-individualisme – bien connues des courants libéraux, voire ultralibéraux – commencent à s’immiscer, masquées par une quête légitime d’autonomie et de liberté. Le parcours entrepreneurial, avec ses impératifs de réussite et ses croyances autour du mérite individuel, en est l’un des vecteurs les plus subtils. Ce n’est pas une conversion brutale, mais une dérive douce, invisible, où l’indépendance et l’argent se muent en valeurs cardinales. Je me rends compte en écrivant tout ceci, que cet égoïsme était en moi bien avant, et que même ma quête artistique et d’expression de ma singularité, a toujours été parfois teinté d’un égoïsme, qui doit donc être accueilli, tout en cultivant l’ouverture, le partage, la générosité, l’altruisme, la solidarité universelle.
Les mirages de la réussite matérielle
L’entrepreneuriat est un milieu où prospèrent les symboles de réussite matérielle. Ces entrepreneurs, influenceurs, ces « self-made » figures de YouTube incarnent un idéal séduisant : assurance, richesse, succès. On s’inspire, on absorbe, parfois sans voir l’idéologie sous-jacente – celle qui prône le mérite individuel comme aboutissement ultime. Mais il y a un piège : la pensée finit par dériver, happée par ces modèles, vers une glorification de la performance qui occulte d’autres valeurs. L’accomplissement personnel, le gain matériel deviennent des absolus, comme si, soudain, ils étaient les seules unités de mesure.
Entre adaptation et subversion
L’entrepreneuriat impose un cadre de pensée orienté vers l’efficacité, l’optimisation, où la liberté individuelle s’habille d’un pragmatisme qui dévie subtilement l’attention vers l’intérêt individuel. Il n’y a rien d’incompatible, en soi, entre ces valeurs et une vision humaniste. Mais il est facile de perdre pied, absorbé dans une logique où la recherche d’autonomie éclipse l’engagement collectif. Et sans vigilance, on devient un rouage de ce système, même si l’on garde ses principes.
Ce chapitre est un rappel : même en agissant de bonne foi, il est aisé de se voir influencé, dérouté de ses idéaux. Rester lucide est un travail quotidien, une discipline qui exige de traquer ces « logiciels mentaux » qui altèrent la perception. La multiperspective ne consiste pas uniquement à observer le monde sous divers angles, mais à commencer par soi. Cet exercice d’introspection n’est ni masochisme, ni autocritique punitive ; c’est un chemin vers une honnêteté plus rigoureuse, la seule manière de préserver une certaine clarté de vue.
Entre libertés individuelles et responsabilité collective
En prenant du recul, la multiperspective se révèle être cet équilibre entre aspirations personnelles et conscience collective. Que l’accomplissement personnel soit légitime ne signifie pas qu’il soit totalisant. Ce chapitre est une invitation à s’observer avec lucidité, à interroger ces influences, à cultiver une vigilance qui ouvre à la pensée libre et indépendante.
Quand j’ai découvert Yomi Denzel sur YouTube, son image était celle de la performance et du succès matériel, un homme compétitif jusqu’au bout des ongles. Un monde qui m’échappe, car je n’ai jamais adhéré à cette frénésie de performance. Mais en écoutant son podcast “Sans permission”, j’ai perçu un autre Yomi : sincère, humain, animé d’une vision bien plus riche. La dualité de son personnage, cet équilibre entre humanité et compétitivité, a révélé l’impact de ces « logiciels mentaux » que nous adoptons parfois sans questionner. J’ai vu là une leçon : il est possible de chercher une réussite matérielle sans renoncer à une bienveillance naturelle.
Oussama Ammar, figure de l’entrepreneuriat à l’esprit rebelle, fascine autant qu’il trouble. Il incarne cette volonté de tout bouleverser, tout en prônant un modèle où chacun prospère sans la moindre contribution collective. Le paradoxe est flagrant : il critique un système, mais en a largement profité. Derrière ses discours et sa figure d’ultralibéral, se cache un homme passionné par les récits visuels, les dessins animés, et je dois reconnaître que, malgré nos divergences, j’aimerais collaborer avec lui, tant l’humanité perce à travers son discours. Il y a en lui, comme chez beaucoup d’entrepreneurs, une contradiction essentielle : cette aspiration à un monde plus juste qui entre en collision avec une vision radicale de l’indépendance.
L’ultralibéralisme et ses pièges
Des figures comme Oussama et Yomi prônent une liberté totale, mais cette vision ignore la complexité du tissu collectif qui leur a permis de se hisser là où ils sont. En rejetant toute contribution au collectif, ils masquent cette interdépendance qui fonde la société. Ce libéralisme radical, qui refuse de se plier aux exigences de l’impôt (qui, à bien des égards pose problème, puisque le citoyen lambda n’a pas de véritable souveraineté sur “comment son impôt est dépensé et est-ce que celui-ci ne sert pas à engraisser des rentiers riches ou des assistés pauvres ?”) c’est là toute la force de la multiperspective, réussir à comprendre des points vues jusqu’alors insaisissables et plus je creuse, plus je souhaite sortir de toute logique de camps politiques ou d’idéologies d’écuries, mais il est également vrai de dire que cela finit par produire une élite déconnectée de la réalité des autres, qui ne voit pas que la réussite repose sur un cadre que le collectif permet de maintenir. Les élections législatives anticipées de 2024, ont provoqué en moi un choc psychologique et une très forte réactivation de mon engagement personnel en faveur des droits humains, de la démocratie, de l’évolution du monde. Je ressens une nécessité souveraine de contribuer, d’apporter mes analyses. Cet essai s’inscrit dans cette démarche de réveil personnel à ce qui me dépasse et me semble pourtant si essentiel.
L’influence consumériste : le logiciel de notre époque
Nous vivons dans une société où la consommation règne en impératif, où l’identité se mesure aux biens matériels et à l’apparence. La Télévision, Les médias, YouTube, les réseaux sociaux, tout conspire pour imposer cette norme. On en vient à intégrer sans s’en rendre compte cette logique.. Même ceux qui aspirent à des valeurs humanistes ne sont pas à l’abri ; la société de consommation façonne notre imaginaire collectif avec une efficacité redoutable.
Comment instaurer des espaces où les voix divergentes peuvent s’exprimer sans se nier les unes les autres ? Comment construire une démocratie qui dépasse les clivages idéologiques et donne une place réelle à chacun ? Ces questions sont un appel à imaginer, à projeter une démocratie où la diversité des idées et des influences nourrit la pensée collective.
Chapitre 8 : Comment faire la révolution en France rapidement – Vers une démocratie citoyenne et écologiste
Ce chapitre propose une vision radicale pour réformer la démocratie en France, non par des partis politiques traditionnels, mais en réunissant la société civile sous une même bannière citoyenne, écologiste, et souverainiste au sens inclusif du terme. L’idée est simple : fédérer les activistes, les associations, et les citoyens autour d’une plateforme commune, éloignée des clivages politiques habituels, et qui défende une vision souveraine et écologique pour la France, tout en se distançant des influences politiques polarisantes de l’extrême droite, de l’extrême gauche, ou du néolibéralisme actuellement au pouvoir. Puisque les médias ne remplissent plus le rôle de contre-pouvoir, il est grand temps que la société civile, toutes classes sociales confondues, toutes tendances politiques confondues, en particulier les 16 millions d’abstentionnistes (33% du corps électoral en 2024, qui a pourtant vu une participation record qui n’avait pas été observée depuis 1988), les abstentionnistes représentent à eux seuls une majorité silencieuse et invisible. Non, ma vision d’une (R)évolution n’est pas violente et ne perd pas tellement son temps à manifester ou organiser des grèves, parce que j’observe les résultats mitigés de ce type d’actions, qui a bien sur toute sa légitimité et importance. Simplement, j’ai le sentiment que plein de méthodes et actions révolutionnaires existent, mais n’ont pas encore été activées à grande échelle, y compris internationales.
Construire une force citoyenne : rassembler la société civile
La première étape consiste à fédérer les activistes, les ONG, les associations de défense de l’environnement, les collectifs citoyens, et tous les mouvements en quête de changement. L’objectif est de former une force véritablement citoyenne, avec une structure qui ne dépend pas d’idéologies partisanes. Cela signifie construire une base qui soutient des principes clairs : l’indépendance de la France vis-à-vis des pressions internationales (sans verser dans le nationalisme), la protection des droits humains, l’écologie, et une réelle démocratie participative. L’ouverture à toutes les tendances politiques, la recherche de sortir des polarisations et des murs politiques, tout en gardant un cap très clair et profondément en faveur des droits humains, de l’épanouissement du plus grand nombre, en refusant toute tendance au rejet de minorités ou d’accusations de parties de la société d’être les responsables des malheurs et des problèmes de la dite société. Autrement dit, le racisme et le sexisme n’ont pas leur place dans ce projet de société, par contre de répondre à toutes les problématiques liées aux inégalités sociales, culturelles, aux questions d’immigration et d’intégration sociale. Améliorer les conditions de tous, sans favoritisme ni création de nouvelles inégalités.
Le projet peut se financer facilement : un appel à contribution symbolique d’un euro par personne. Si vingt millions de citoyens y participent, cela créerait un fonds de vingt millions d’euros, suffisant pour lancer une campagne électorale solide et démocratique. Cela permettrait de contourner les financements de lobbies et de grandes entreprises, pour que ce mouvement reste indépendant et fidèle à ses valeurs. C’est fou de se dire que le changement global d’une société ne tient finalement qu’à la décision collective d’une part suffisamment large du corps électoral, de financer les instruments politiques lui permettant d’opérer ce changement démocratique majeur souhaité par la majorité silencieuse. Certains me diront que ce n’est qu’une utopie de plus, que tout cela est impossible. Possible, mais je crois fermement que même les 120 000 militaires l’armée française seraient ravis d’un tel changement, je suis convaincu que l’ensemble des Gilets Jaunes, souverainistes pro RIC, associatifs, électeurs de gauche et écologiste, à part peut être les hyper modérés partisans de cazeneuve et consorts, seraient ravis qu’une telle liste avec suffisamment de moyens de communication, puisse exister.
Il serait évidemment important que les partis progressistes, par acte de courage politique fort et conscience de l’enjeu démocratique, retirent leur candidatures et apportent leur soutien sans participation à ce mouvement, le mouvement du peuple. Je pense sincèrement que les partis réellement humanistes, si ils voient que cette liste de la société civile arrive effectivement à récolter plus de 10 millions d’euros/ dix millions de personnes la soutenant, décideront, par courage politique et conscience des enjeux, de soutenir ce mouvement du peuple. Évidemment, l’idée est la suivante : Pas de coup de force, pas de manipulation des foules, la démocratie dans toute sa splendeur, avec une approche multi perspective pour tenter de réunir tous les citoyens qui souhaitent un véritable renouveau démocratique en France. L’une des clés est évidemment une communication à grande échelle.
Un candidat consensuel : ni partisan ni clivant
Pour incarner cette vision, il est crucial de choisir une figure consensuelle, capable de transcender les clivages politiques et de représenter réellement les citoyens sans être prisonnière d’alliances partisanes. Ce candidat ne doit pas soutenir des figures polarisantes comme Obama, Biden, Trump, Macron, Mélenchon, Lepen, Bardella, etc. ou même des dirigeants étrangers. Il/elle doit rester neutre et symboliser un désir de changement pacifique, tout en étant assez charismatique pour attirer un large soutien.
L’idée est d’avoir une figure temporaire, non pas pour incarner un “leader” au sens traditionnel, mais pour servir de pont vers un nouveau système. Le rôle de ce candidat serait de mener une transition vers une démocratie participative, où les citoyens ont un rôle actif et réel dans les décisions politiques. Le mandat serait donc court et orienté vers la mise en place d’une réforme constituante. L’objectif ultime serait de transformer le système politique avec des outils comme le RIC (référendum d’initiative citoyenne), en instaurant une structure de consultation citoyenne continue, permettant aux citoyens de participer activement aux décisions. Beaucoup de possibilités existent, l’embarras du choix de possibles joyeux et constructifs existe, tout en étant dans une dynamique de conscience que l’organisation actuelle du monde fera tout pour empêcher cela, mais… un tel projet, fera phare de lumière pour les peuples de la paix, dans le brouillard mondial.
Une révolution démocratique et écologique
Ce mouvement aurait pour mission de refonder la démocratie en France, non pas pour se couper du monde, s’appauvrir, augmenter les dépendances, mais pour créer un modèle plus autonome, résilient, et orienté vers le bien commun. Cela implique de redéfinir les relations de la France avec des institutions internationales comme l’Union européenne, en cherchant à construire une Europe véritablement démocratique et écologique, plutôt que de s’enfermer dans une structure qui privilégie souvent les intérêts financiers et économiques. Cette approche pourrait inspirer d’autres pays européens, créant une nouvelle forme de coopération fondée sur la souveraineté universelle et le respect de l’environnement.
Chapitre 9 : La grève des paiements – une action de désobéissance civile puissante
Dans ce chapitre, l’idée d’une grève des paiements est proposée comme un moyen de pression démocratique et pacifique. Ce serait un acte de désobéissance civile, une forme de résistance collective où les citoyens refuseraient de payer certaines factures et taxes tant que le gouvernement ne respecte pas la volonté populaire ou les principes de la vraie démocratie.
L’idée est simple et belle : si un grand nombre de citoyens, disons des millions, cessent de payer leurs factures, cela crée une pression économique directe sur l’État et les entreprises qui dépendent de ces revenus. Que ce soit pour les factures d’énergie, les impôts locaux, ou même certains frais administratifs, l’objectif serait de paralyser les flux financiers pour forcer le gouvernement à prendre en compte les revendications démocratiques. Pour que cette action soit efficace et légitime, elle devrait être soutenue par une coalition large de mouvements citoyens, y compris des syndicats, des partis de gauche et même de l’extrême droite, des activistes écologistes, des humanistes, ainsi que des acteurs du secteur associatif. Tous les citoyens partageant les valeurs démocratiques et désirant une Réforme démocratique majeure en France. Cela pourrait aussi être les millions de soutiens à cette fameuse candidature du Peuple.
Les risques et les forces de la grève des paiements
Bien sûr, une telle action comporte des risques juridiques et des conséquences individuelles. Les participants pourraient être confrontés à des amendes, des coupures de services, et d’autres répercussions. Mais si l’adhésion est massive et coordonnée, les pouvoirs publics se retrouveraient dans l’impossibilité de réprimer l’ensemble des citoyens impliqués. Cette forme de désobéissance civile, bien que risquée, est pacifique et peut être très efficace pour éveiller les consciences et attirer l’attention sur les dysfonctionnements du système.
Cette action ne vise pas à déstabiliser l’État pour le simple plaisir de se plaindre, mais bien à exiger des réformes profondes, une reconnaissance de la volonté citoyenne, et une réévaluation du contrat social. Le message est clair : si l’État ne respecte pas ses citoyens, ceux-ci ont le droit et même le devoir de trouver des moyens de pression pour se faire entendre. C’est ce qu’ont fait les irlandais en 2014, quand le gouvernement à voulu privatiser la régie publique de l’eau et augmenter ses tarifs, une grève nationale, des factures d’eau, ont fait reculer le gouvernement et obtenu gain de cause.
Chapitre 10 : L’Europe Face aux Puissances Impérialistes : Opportunités pour un Modèle Alternatif.
L’Europe se trouve à un carrefour historique, prise en étau entre trois visions impérialistes du monde. D’un côté, les États-Unis, autoproclamés garants de la liberté, mais dont la politique extérieure sert, au fond, un modèle guerrier, autoritaire, et de plus en plus aligné sur des intérêts oligarchiques et privés. Derrière le masque de la démocratie, cette puissance développe une machine de guerre perpétuelle, guidée par l’influence écrasante du complexe militaro-industriel. En interne, elle consolide un cadre de contrôle social, fait de surveillance et de manipulation de l’opinion, étendant son empreinte dans la sphère de l’éducation, de la santé, et au sein même des droits fondamentaux. Les peuples du monde, victimes de cette prétendue « paix imposée », peinent à résister aux ravages de ses interventions successives, orchestrées pour maintenir l’hégémonie de l’Amérique, et assurer la domination d’une minorité élitiste qui se joue des valeurs de liberté.
De l’autre côté, la Russie, incarnant une autre forme de régime autoritaire, impose son contrôle par la force et une idéologie de résistance construite sur des récits nationalistes et religieux. En positionnant son État comme un bouclier contre l’impérialisme occidental, elle s’engage dans une propagande qui glorifie la guerre et diabolise les valeurs de liberté civile, les droits des femmes et des minorités. Derrière le rideau de fer de ce récit anti-occidental, la Russie déploie des stratégies qui écrasent les voix dissidentes et étouffent toute possibilité de démocratie citoyenne, sacrifiant des vies au nom d’un autre impérialisme.
Enfin, plus discrète mais non moins influente, la Chine avance une forme de contrôle global par la technologie et la surveillance de masse. Le modèle chinois, qui unit surveillance numérique et contrôle social, montre que l’autoritarisme peut prendre la forme d’une hégémonie silencieuse, où les technologies de contrôle façonnent la société pour garantir la stabilité d’un régime unique et immuable. Dans ce système, l’individu devient un rouage d’un dispositif de domination mondiale, qui cherche à redéfinir la liberté selon ses propres termes : obéissance, soumission et stabilité.
Pourtant, dans ce paysage de domination croissante, l’Europe possède une occasion unique de se démarquer et d’incarner un modèle alternatif. Elle peut choisir une voie autonome, un chemin qui ne serait ni impérialiste ni soumis aux jeux de pouvoir des grandes puissances. Ce modèle pourrait se construire sur trois piliers essentiels : la transition écologique, la justice sociale et la paix. Évidemment, cette perspective passe par des évolutions démocratiques et citoyennes dans les nombreux pays d’Europe.
L’Europe, en affirmant une indépendance réelle, pourrait s’ériger en protectrice des droits humains à l’échelle mondiale, en soutien des initiatives de désarmement et en promotrice d’une politique d’accueil pour les voix progressistes. Elle aurait la possibilité de montrer au monde qu’une puissance peut être autre chose qu’un oppresseur : elle peut aussi être une source d’inspiration, une alliée pour les peuples et un moteur de justice climatique et sociale.
Toutefois, pour que cette Europe existe et se réalise, la démocratie et l’État de droit doivent être restaurés et consolidés en France, car sans ces fondations, l’Europe n’est qu’un fantôme de puissance, prêt à se dissoudre dans les jeux de domination. Dans de nombreux pays européens, on observe une lente érosion de la démocratie, souvent masquée par des discours de sécurité nationale et d’ordre social. La France, l’Italie, la Pologne, la Hongrie – des nations autrefois bastions de la liberté civile, plongent désormais dans des régimes où la voix du progrès est en recul, et où la gouvernance se fait à huis clos, au mépris des résultats électoraux et des droits des citoyens.
En Afrique du Nord, à 1 500 kilomètres de Paris, la Tunisie offre un exemple frappant de ce basculement vers l’autoritarisme. Pays dans lequel une fenêtre démocratique s’est ouverte, réveillant les espoirs de tout un peuple, qui a duré à 10 ans (2011-2021), la Tunisie est aujourd’hui de nouveau sous un régime dictatorial, dans le silence complice des médias occidentaux qui détournent le regard. ayant vécu en Tunisie de 2018 à 2023, j’ai observé le changement de régime, progressif et violent. Je continue une étude sur le sujet que je souhaite publier également.
Si l’Europe renonce à cette chance de bâtir un modèle démocratique, et véritablement humaniste, elle risque de n’être qu’une copie affaiblie des régimes autoritaires qu’elle prétend critiquer. Pourtant, les voies existent pour qu’elle devienne un modèle de puissance altruiste et démocratique. Soutenir activement les droits humains, promouvoir la coopération internationale, instaurer des partenariats écologiques, cohérents et soutenant pour les peuples, œuvrer pour la paix, une paix fondée sur l’entente et la protection des peuples, une paix digne de ce nom. Cette Europe, ce n’est pas l’UE telle qu’elle existe actuellement, inféodée par les lobbies et non démocratique. Cette Europe des Peuples, ne sera pas une perte de souveraineté, mais au contraire, en sera la garante. Bien sûr, cette perspective exige une Défense Européenne indépendante, permettant de sortir de l’étau des impérialismes, qui chercheront inévitablement à imposer leur domination. Le désarmement mondial sera progressif, et directement lié à un apaisement mondial des tensions. Sous entendu, il est malheureusement impossible à ce stade de se désarmer face à des puissances autoritaires avides d’agrandir leur “zones d’influences”.
Chapitre 11 : La santé de l’humanité – individuelle, collective et planétaire
Ce chapitre plonge dans la notion de santé mentale individuelle et de santé collective de l’humanité, comprenant à la fois les aspects physiques et psychologiques, tout en intégrant des perspectives écologiques. La vision que chaque individu porte sur le monde est profondément influencée par son état de santé, ses perceptions, et ses expériences. Une humanité en bonne santé, tant mentalement que physiquement, est une condition favorable pour construire un monde plus juste, plus pacifique, et plus harmonieux.
La santé mentale n’est pas simplement un enjeu personnel ; elle a des répercussions collectives. Dans un monde où l’anxiété et la dépression touchent des millions de personnes, il est fondamental de poser la question de l’impact de la santé mentale collective sur les dynamiques sociales et politiques. Comment l’état de souffrance ou de bien-être d’une population influence-t-il ses choix politiques, sa résilience, et sa capacité à coopérer ? Et plus largement, comment créer des environnements, y compris politiques, qui favorisent le bien-être psychologique, la sécurité émotionnelle, et la stabilité ?
En parallèle, aborder la santé collective implique de considérer les dynamiques sociales qui affectent la psychologie des peuples. Les crises successives, qu’elles soient économiques, climatiques ou sanitaires, contribuent à une pression psychologique intense. Une des solutions serait de créer des politiques publiques favorisant la santé mentale à l’échelle sociétale, en intégrant le bien-être comme priorité dans les décisions politiques et économiques.
La santé physique, écologique et systémique
La santé de l’humanité ne se limite pas à la santé mentale ; elle inclut également la santé physique et écologique. La crise écologique actuelle met en lumière le lien étroit entre la santé de l’environnement et celle des populations. La pollution de l’air, la qualité de l’eau, et les changements climatiques ont des impacts directs sur la santé physique, mais aussi mentale. Les initiatives qui visent à régénérer la planète – à restaurer les écosystèmes, à promouvoir des agricultures durables – ne sont pas seulement des actions pour l’environnement ; elles sont aussi des actions pour la santé globale des peuples.
Dans cette perspective, on peut imaginer une approche de la santé qui soit véritablement systémique. La santé de chaque individu est liée à la santé de sa communauté, qui elle-même est connectée à la santé des écosystèmes. Penser la santé de manière holistique, c’est repenser notre modèle de société dans son ensemble, pour que l’économie, la politique, et les modes de vie soient orientés vers un bien-être commun.
Chapitre 12 : Peuples et gouvernements : pour une démocratie vivante et internationale au service des citoyens
Les crises politiques, écologiques, et sociales contemporaines révèlent une fracture persistante : celle qui sépare les gouvernements de leurs peuples. Lorsque l’on parle d’un pays, on désigne trop souvent sa population par ses actions politiques. « La Russie », « l’Iran », « les États-Unis » deviennent alors des synonymes des décisions de leurs dirigeants. Mais cette simplification occulte une réalité incontournable : les peuples et les gouvernements ne partagent ni les mêmes intérêts ni les mêmes valeurs. La distinction entre ces deux entités est essentielle pour comprendre les dynamiques mondiales actuelles et pour envisager une réorientation des relations internationales – non pas entre États, mais entre peuples.
Le divorce entre peuples et gouvernements
Dans de nombreux pays, les gouvernements sont composés de petites élites politiques, économiques ou militaires, qui exercent un contrôle souvent démesuré sur la vie de leurs citoyens. Ces gouvernements n’agissent pas toujours en fonction des besoins ou des aspirations des populations qu’ils représentent. L’exemple iranien est parlant : une grande partie de la population aspire à plus de libertés individuelles et à un changement social profond, mais se retrouve souvent opprimée par un pouvoir central conservateur. De la même manière, les Russes ne peuvent être réduits aux actions de leur État ; nombreux sont ceux qui rêvent de réformes démocratiques et d’un rapprochement avec d’autres cultures, mais se voient entravés par un régime autoritaire.
Ce divorce entre gouvernants et gouvernés est loin d’être une spécificité des régimes autoritaires. Dans les démocraties occidentales, la distance se creuse également entre les attentes des citoyens et les décisions des gouvernements. Aux États-Unis, par exemple, les citoyens soutiennent majoritairement une réglementation plus stricte des armes à feu et des réformes pour rendre le système de santé plus accessible, mais ces attentes sont négligées par des élites politiques influencées par des lobbies.
La souveraineté des peuples : une solidarité internationale
Si les intérêts des peuples et des gouvernements divergent, il est légitime de repenser la façon dont les nations coopèrent et se soutiennent. Une véritable solidarité mondiale devrait être fondée non sur des alliances entre gouvernements, mais sur des liens entre peuples. Soutenir la souveraineté des peuples implique de reconnaître leur droit à l’autodétermination et leur dignité, sans confondre cet engagement avec un appui aux élites ou aux oligarchies qui les dominent.
Cette souveraineté populaire (mais absolument pas populiste) doit également se libérer de l’influence des grandes puissances économiques et politiques. Trop souvent, les dirigeants justifient des politiques autoritaires ou des réformes pourries au nom d’un « bien commun » qui masque des intérêts de lobbies multiples et trop puissants.. Si l’on souhaite construire un futur où les peuples sont réellement entendus, il faut reconnaître que les alliances politiques traditionnelles ne suffisent plus – et que la véritable souveraineté passe par des réseaux internationaux de coopération citoyenne, notamment en matière de justice climatique, de protection des droits humains, et de transition économique.
Chapitre 13 : Vers une démocratie vivante : interactive et au service des citoyens
Face à l’inefficacité des systèmes actuels, il est urgent de transformer nos démocraties en des espaces dynamiques et pragmatiques. Trop souvent, la démocratie est perçue comme une mécanique lourde, interminable, et inefficace, où chaque décision semble s’enliser dans un processus de validation complexe. Pourtant, une démocratie participative moderne pourrait être rapide, engageante, et innovante, en mobilisant les citoyens de manière bénéfique et régulière, sans sacrifier la qualité des décisions.
Des outils numériques permettent aujourd’hui d’imaginer une démocratie vivante, où les consultations publiques, les assemblées citoyennes, et les votes sont facilités par la technologie, qui doit elle-même s’inscrire dans la logique du WEB 3, décentralisé, propriété commune des peuples, inviolables. Les consultations fréquentes – sur des enjeux locaux comme mondiaux – donnent aux citoyens le pouvoir de participer aux décisions qui les concernent réellement. Les assemblées locales, en ligne et en réel,, mises en place régulièrement, permettent une prise de décision à l’échelle humaine, où chaque voix compte, sans tomber dans les débats sans fin.
Une démocratie rapide et vivante ne doit pas être un système purement théorique, mais un ensemble de pratiques concrètes au service des intérêts de la communauté. Par exemple, des plateformes numériques pourraient recueillir les avis citoyens en temps réel, permettant ainsi une gouvernance agile et proche de ses administrés. Les villes et les villages pourraient organiser des sessions régulières de discussion publique où les habitants décident de l’avenir de leurs espaces communs, de leurs projets écologiques, ou encore des budgets pour les infrastructures locales.
L’enjeu est de créer une démocratie où l’efficacité n’est pas un synonyme de rapidité aveugle, mais un équilibre entre pragmatisme et bien-être commun. Dans un tel système, chaque décision est prise en fonction des valeurs de santé publique, de justice, et de respect de l’environnement, renforçant le lien entre les citoyens et leur gouvernement. Ce modèle permettrait non seulement de redonner confiance aux populations dans leurs institutions, mais aussi d’accélérer les processus décisionnels, souvent trop rigides pour répondre aux défis contemporains.
Aujourd’hui, les frontières politiques peinent à contenir les défis globaux. L’urgence climatique, les inégalités économiques, ou encore les crises sanitaires soulignent une interdépendance croissante entre les nations. Dans ce contexte, l’implication directe des peuples devient essentielle. Si les gouvernements échouent à protéger le bien commun, alors il revient aux citoyens de construire des ponts entre les communautés, de promouvoir les initiatives locales et de s’organiser pour pallier les lacunes des élites.
Les peuples, dans leur diversité, sont porteurs de solutions et de valeurs universelles. Plutôt que de se résigner à la fatalité d’un monde dominé par les intérêts de quelques-uns, ils peuvent devenir les acteurs d’un changement réel, en coopération les uns avec les autres. Cette transition vers une société plus juste et écologique passera par des alliances internationales fondées sur la solidarité et non sur la compétition.
Redéfinir la démocratie pour en faire un outil agile, inclusif, et rapide est un défi que nous devons relever ensemble. Ce modèle démocratique, loin d’être une utopie, est une nécessité face aux défis de notre époque. Et en parallèle, reconnaître les peuples pour ce qu’ils sont – des entités distinctes des gouvernements – permettra de créer des alliances plus authentiques, qui respectent la souveraineté et les aspirations de chaque communauté.
Les peuples du monde sont prêts pour une démocratie qui répond réellement à leurs besoins, pour une démocratie à leur image : vivante, pragmatique, et tournée vers le bien commun. En renforçant la solidarité entre citoyens, en encourageant les projets participatifs, et en repensant les structures politiques, il est possible de concrétiser une société nouvelle, plus juste et en harmonie avec la planète. La révolution démocratique, si elle doit arriver, sera portée par cette force citoyenne, unie, diverse, et libre.
Chapitre 14 : Une contribution à un dialogue plus vaste
Au terme de ce parcours, je tiens à revenir sur un point essentiel : ce petit livre n’est pas une leçon, ni une vérité absolue. Bien qu’il soit le fruit de mes observations, et de mes recherches sérieuses et multi sources, il reste un miroir de mes propres limites, de mes biais, et de mes perceptions inévitablement simplifiées du monde complexe qui nous entoure. Ce que j’ai proposé ici, ce sont des fragments de ma pensée, une vision, un récit du réel, d’une époque trouble, qui je l’espère apporte de la clarté et une vision renouvelée des enjeux et possibles, car contrairement à la petite musique ambiante, une (R)évolution citoyenne n’a jamais été autant possible que maintenant.
La vérité est vaste, multiple, et elle évolue sans cesse. Chaque lecteur, avec son intelligence, son expérience, et sa propre analyse, est aussi un explorateur de cette vérité. Mon intention, en partageant ces pages, est simplement d’ajouter une vision prospective à l’édifice, un point de départ pour des actions, pour des dialogues. Les idées que j’ai partagées sont perfectibles, et c’est avec humilité que je les soumets à votre jugement.
Je suis conscient que certains aspects pourraient être contredits, révisés, enrichis, ou même réfutés. C’est normal, et c’est ainsi que l’on avance. Il n’impose rien, il ne dicte rien. Il propose, il esquisse, il invite à poursuivre une réflexion que j’espère collective, et qui ne cesse d’évoluer. Je remercie tous ceux qui auront pris le temps de lire, de réfléchir, de critiquer, de questionner. Vous êtes les véritables porteurs de ces idées, ceux qui leur donneront vie, forme, et sens. Pour conclure, cet essai est fondé sur une recherche de cohérence et clarté, en m’appuyant sur des informations vérifiables, fruits de mes recherches multiples, à travers le prisme de ma vision du monde.
À chacun, donc, de prendre ce qui résonne, de laisser ce qui ne correspond pas, et de continuer à contribuer à ce dialogue permanent qu’est la quête de progrès et de paix pour tous.
Carlos Chapman, Novembre 2024
#peuplespourlapaix #mouvementdespeupliers

Partager cet article:
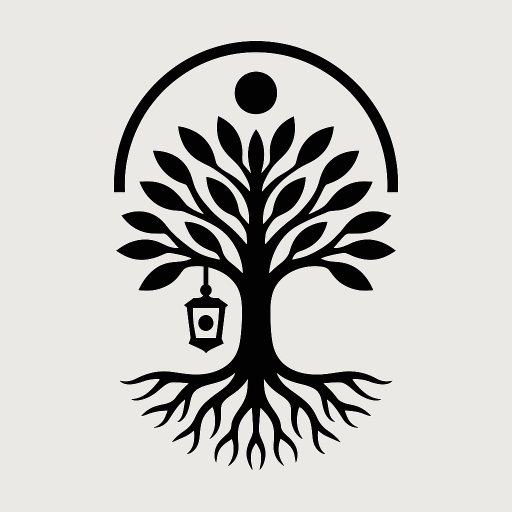


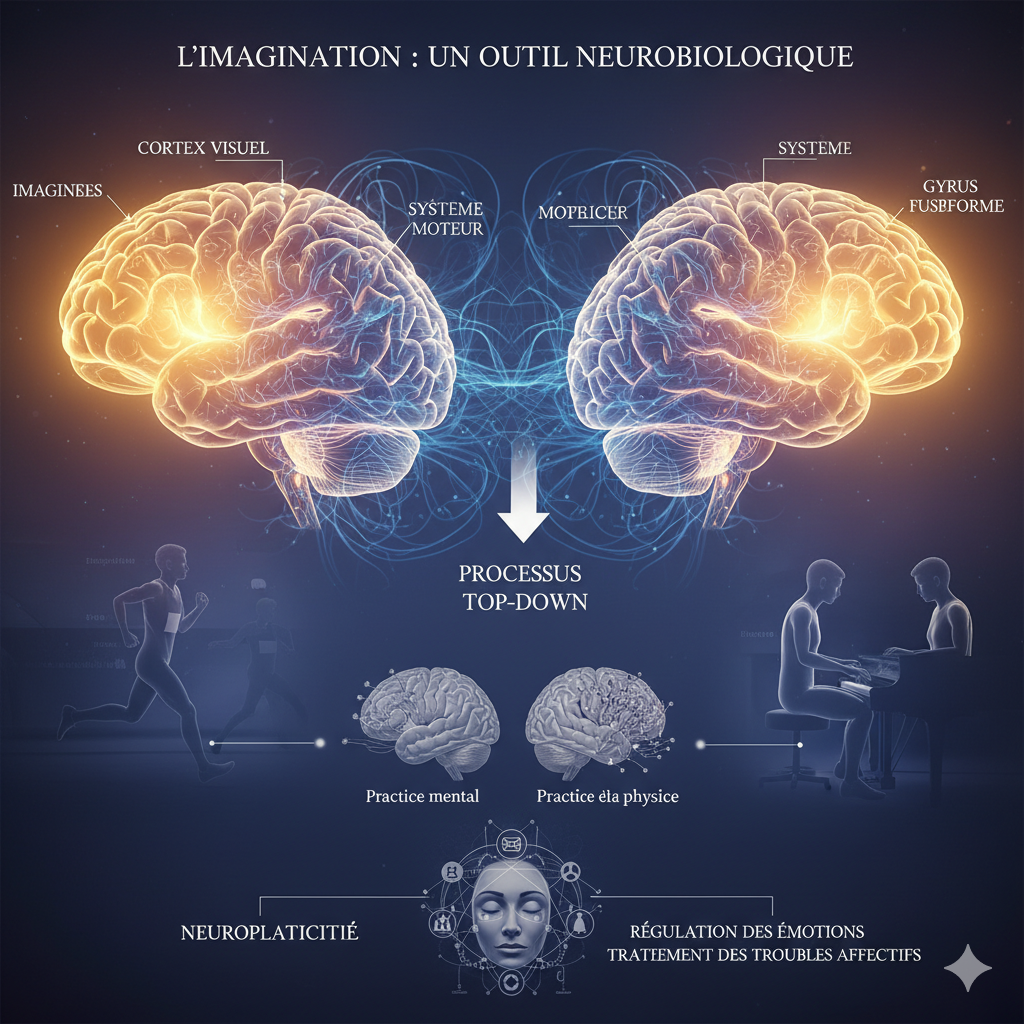

Laisser un commentaire