Article géopolitique et références cinématographiques. Dystopie 2025.
Quand j’étais gamin, Judge Dredd avec Stallone, c’était juste un film d’action démesuré, une parodie involontaire où tout était trop grand, trop bruyant, trop caricatural pour être pris au sérieux. Je riais devant la démesure, les punchlines martelées, la justice expéditive d’un monde réduit à une machine grotesque où un seul homme pouvait incarner la loi, le juge et l’exécuteur. C’était absurde, c’était drôle. Puis, en grandissant, le rire s’est transformé en un léger vertige. Parce qu’en fait, cette farce tenait debout. Trop bien, même.
Aujourd’hui, ce qui relevait de la satire dystopique a muté en réalité, mais dans une version bancale, grotesque, où l’exagération n’a plus rien d’un art. Trump, Musk et consorts se sont emparés de la logique du film, de la punchline comme gouvernance, de l’exécution médiatique comme verdict ultime, du mépris des institutions au profit d’un pouvoir qui ne s’embarrasse plus d’arbitrage. La brutalité devient un projet politique, la vulgarité une stratégie de communication, la pensée un obstacle à écraser sous des slogans. Comme Dredd, ils ne s’excusent de rien, se déclarent seuls garants d’un monde en ruines, hurlant au complot dès qu’ils sont contredits, érigeant leur propre tribunal où la foule, chauffée à blanc, acclame chaque condamnation arbitraire. Ils ne gouvernent pas, ils scénarisent leur toute-puissance.
Et pourtant, il manque quelque chose. Dans Judge Dredd, Mega-City One est une fatalité. Une caricature démesurée qui repose sur un monde en ruine, où tout a déjà échoué et où la seule réponse est la force. Mais nous, nous ne sommes pas dans un film. Le pire n’est pas encore gravé dans le marbre, et la dystopie n’a de pouvoir que si on accepte son scénario. Il y a un trou dans leur récit, une faille dans leur autorité de pacotille, un vide béant que l’on peut encore combler avec autre chose qu’un marteau brandi à bout de bras. L’ironie ultime, c’est qu’ils n’ont de puissance que celle qu’on leur accorde. Ils ne créent rien, ils réagissent. Ils ne bâtissent pas, ils récupèrent. Ils ne pensent pas, ils assènent. Et l’histoire leur échappera toujours, parce que l’avenir n’est pas un monologue de Stallone éructé sur fond de décors en carton-pâte.
Leur dystopie n’est qu’un décor de cinéma, mal éclairé, mal monté, un bruit de fond qui tente de masquer ce qui germe ailleurs. Ce qui est en marche ne peut pas être jugé, exécuté ou éradiqué d’une punchline. C’est plus fluide, plus complexe, plus organique. Ce sont les millions de trajectoires sincères qui se connectent, les cœurs qui éclairent autre chose qu’un récit de peur, les peuples qui prennent conscience que la justice n’est pas une affaire de bras armé mais de conscience partagée. Le futur se façonne dans ces interstices, dans ces respirations.
Leur film est pourri. Il leur reste leur rôle, grotesque et daté, et l’illusion d’une toute-puissance qui se fissure dès qu’on cesse d’y croire. Ce n’est pas Judge Dredd qui nous attend. C’est autre chose. Une autre histoire. Plus vaste, plus ouverte, et surtout, écrite par nous, les peuples.
Je sais c’est une réf cinéma bien catastrophique.

Pour me rattraper, si vous ne connaissez pas, je vous invite largement à découvrir le film « Pleasantville », qui colle également à merveille à la situation actuelle des USA, mais en beaucoup plus poétique, doux et subtil.
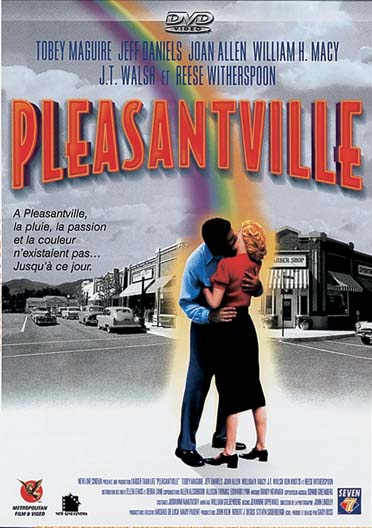
Pleasantville (1998), écrit et réalisé par Gary Ross, ce film joue sur une esthétique rétro pour mieux dynamiter l’illusion d’un passé figé. Sous ses airs de fable douce-amère, il raconte la transition d’un monde enfermé dans un ordre apparent, un conservatisme étouffant, vers une explosion de couleurs, de chaos, mais aussi de vie et de complexité. Il parle du passage de l’illusion d’un monde parfait à la découverte du réel, avec toutes ses nuances, ses contradictions et sa puissance transformatrice.
Si Judge Dredd met en scène une dystopie brute où la loi devient un rouleau compresseur, Pleasantville propose une métaphore plus fine : celle d’un monde où tout est maintenu en noir et blanc, où l’ordre existe parce que personne ne pense à le remettre en cause. Mais dès que des éléments extérieurs viennent perturber cette inertie, la couleur apparaît. Et avec elle, la conscience, le désir, le questionnement, la complexité, la liberté. Ce n’est pas un soulèvement brutal, ce n’est pas une guerre : c’est un éveil progressif, irréversible, qui transforme tout.
Le lien avec notre époque néoféodale : Ceux qui veulent imposer un monde simpliste, polarisé, binaire, gouverné par des figures d’autorité qui « disent la vérité » et tranchent tout à coups de verdicts tonitruants, ne sont en réalité que des gardiens d’un noir et blanc artificiel. Ils vendent un ordre qui rassure, un cadre qui fige, une illusion où tout est « simple ». Mais leur structure est fragile, car elle repose sur le refus du changement, sur la peur de la nuance, sur l’évitement du vivant.
Le futur ne leur appartient pas. Ils sont ceux qui interdisent les livres dans Pleasantville (wikipédia n’est pas à vendre), ceux qui veulent faire reculer la couleur, ceux qui pensent que la stabilité passe par l’uniformité. Mais la couleur revient toujours. L’irréversible est en marche. Ils peuvent se débattre, hurler, légiférer contre ce qui émerge, mais ils ne peuvent pas l’empêcher. Ce qui vit, ce qui se transforme, ce qui s’éveille ne peut être contenu.
Le paradoxe, c’est que leur propre spectacle alimente ce changement. Leurs outrances, leur posture d’autorité excessive, leur besoin de simplifier à l’extrême finissent par révéler à quel point leur modèle est creux. Ils veulent faire croire qu’ils sont la seule réponse, mais ils sont en réalité le dernier spasme d’un monde qui ne peut plus tenir.
Le film est fini. Le noir et blanc craque. Les couleurs gagnent du terrain.
Extraits du magnifique film Pleasantville, cinéma d’auteur et innovant. 1998.
Clip de la chanson cover magnifique faite pour le film :
Extrait, la scène de la peinture murale :
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Judge_Dredd_(film)
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleasantville
Gary Ross : un conteur aux frontières du réel et du possible
Né en 1956, Gary Ross est un réalisateur, scénariste et producteur américain qui a su marier, à travers ses œuvres, une narration classique et une réflexion profonde sur les systèmes, les croyances et les illusions collectives. Avant de devenir réalisateur, il a d’abord été un scénariste acclamé, notamment pour Big (1988), le film culte avec Tom Hanks qui joue sur l’ambiguïté entre enfance et âge adulte, réalité et désir. Ce goût pour le passage d’un monde à un autre, pour la remise en question des cadres établis, est une constante dans son travail.
Son premier film en tant que réalisateur, Pleasantville (1998), est une audace cinématographique qui mêle une esthétique rétro inspirée des sitcoms américaines des années 50 et une critique acérée des conservatismes figés. En utilisant un procédé visuel novateur pour l’époque, où la couleur s’infiltre progressivement dans un monde en noir et blanc, Ross réalise une métaphore frappante du passage de l’ignorance à la conscience, de l’ordre au chaos créateur, de la norme imposée à la liberté assumée. Le film aborde des thèmes aussi vastes que la liberté individuelle, la peur du changement, le refus de l’altérité et l’émancipation des esprits.
Il poursuit ensuite une carrière oscillant entre blockbusters et films engagés. Il signe Seabiscuit (2003), une fresque inspirante sur un cheval de course devenu symbole de résilience en pleine Grande Dépression, avant de surprendre avec Hunger Games (2012), où il adapte l’univers dystopique de Suzanne Collins en insistant sur la critique des médias-spectacles et du pouvoir autoritaire. Son dernier film, Free State of Jones (2016), retrace l’histoire vraie d’un soulèvement anti-esclavagiste mené par un fermier sudiste en pleine Guerre de Sécession, une réflexion sur la révolte contre les systèmes d’oppression.
À la fin des années 90, Hollywood est encore largement dominé par une industrie frileuse en matière de prise de risques formels et politiques. Pleasantville, avec son hybridation entre film rétro et critique sociale, sa réflexion sur la censure et son ton à la fois poétique et subversif, est un pari osé. L’usage progressif de la couleur pour symboliser l’éveil intérieur des personnages est une innovation marquante, nécessitant 1700 plans à effets spéciaux, un défi technique immense pour l’époque.
Les thématiques du film entrent également en collision avec le climat social américain de la fin du XXe siècle : la montée des conservatismes, les débats sur la liberté d’expression, la tension entre tradition et modernité. Ross y glisse des références évidentes aux luttes pour les droits civiques, notamment avec la scène où des façades sont vandalisées simplement parce qu’elles sont « en couleur », un écho clair aux persécutions raciales.
Malgré son audace, le film connaît un accueil critique enthousiaste, même s’il ne rencontre pas un succès commercial massif. Mais son message, lui, résonne bien au-delà de sa sortie.
Pleasantville incarne à merveille une approche multiperspective du monde. Il ne pose pas un conflit entre un camp du bien et un camp du mal, mais illustre comment l’enfermement dans une seule vision du réel produit de la rigidité, du rejet et de l’exclusion. Les personnages en noir et blanc ne sont pas « les méchants » : ils sont des êtres qui n’ont jamais eu la possibilité d’explorer autre chose que ce qu’on leur a imposé. L’évolution du film repose sur la capacité à ouvrir les perspectives, à comprendre que la vérité n’est pas un bloc monolithique, mais une mosaïque qui se révèle à mesure que les esprits s’éveillent.
Ce que propose Ross, c’est une réconciliation entre le passé et l’avenir, une transition non pas par la violence ou l’opposition frontale, mais par l’acceptation de la nuance, de la couleur, de la transformation. C’est exactement cette vision systémique et pacifique qui est au cœur de ma démarche : dépasser les récits binaires, éviter les affrontements stériles, et comprendre que la paix n’est pas l’absence de conflit, mais l’intégration des diversités en un tout cohérent et vivant.
Carlos Chapman
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Ross
Partager cet article:
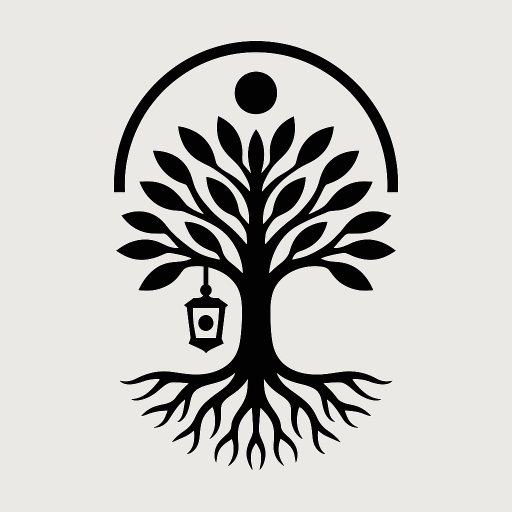
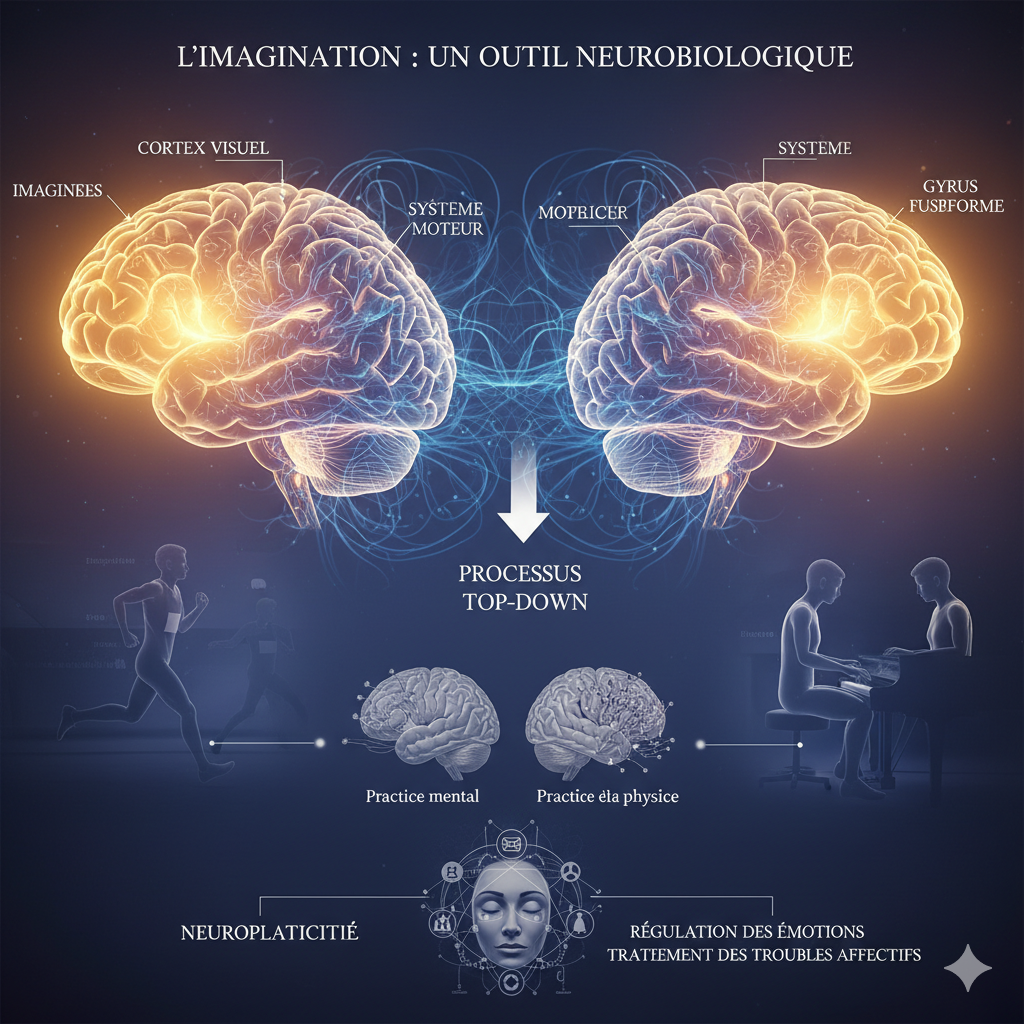


Laisser un commentaire