Introduction
À l’heure où l’intelligence artificielle, les plateformes numériques et les infrastructures technologiques occupent une place centrale dans nos sociétés, se pose une question décisive : qui, à travers les figures telles qu’Elon Musk, Peter Thiel ou Sam Altman, façonne réellement ce futur numérique ? La politologue Asma Mhalla alerte sur un basculement du pouvoir, qui ne se contente plus de gouverner, mais programme. En s’appuyant sur ses écrits (notamment Technopolitique) et sur de nombreuses analyses contemporaines, cet article examine comment le numérique devient un instrument de pouvoir, les enjeux idéologiques qu’il porte, les risques pour la démocratie, et les voies possibles pour repolitiser la technologie.
Le pouvoir technologique comme instrument programmatique
Asma Mhalla décrit ce que l’on pourrait appeler un pouvoir « technopolitique », dans lequel les infrastructures numériques (algorithmes, plateformes, données, intelligence artificielle) ne sont pas de simples outils, mais des architectures qui structurent les rapports sociaux, façonnent l’expérience politique, modèlent les espaces de visibilité et d’influence. (Institut Montaigne)
Elon Musk, Peter Thiel ou Sam Altman incarnent pour Mhalla des figures de ce pouvoir, non parce qu’ils ont simplement de l’influence, mais parce qu’ils élaborent des visions du monde complètes, avec des postures idéologiques, des technologies duales (civil / militaire / informationnelle) et des projets à long terme qui visent à remodeler la gouvernance, la perception, la vérité. (Institut Montaigne)
Les idéologies enrôlées : libertarianisme, long-termisme, transhumanisme, accélérationnisme
Selon les travaux de Mhalla, les techno-tycoons ne sont jamais idéologiquement neutres. Ils mobilisent plusieurs courants intellectuels et philosophiques pour légitimer leurs entreprises : le libertarianisme (valorisant la liberté individuelle, la dérégulation, le marché), le long-termisme (penser les générations futures, la survie à très long terme comme horizon), le transhumanisme ou l’accélérationnisme, qui considerent la technologie comme force de saut dans l’évolution humaine ou sociale. (LES ANNALES DES MINES)
Ces idéologies ne sont pas de simples ornements : elles orientent les choix de données, les priorités des investissements, les collaborations entre États et entreprises, et déterminent ce que sont des risques acceptables, ce qui doit être surveillé, ce qui peut être marginalisé ou exclu. (LES ANNALES DES MINES)
La symbiose Big Tech – États et la dilution de la démocratie
Mhalla insiste sur le fait que les géants de la tech fonctionnent aujourd’hui en symbiose avec les États – non pas simplement comme prestataires ou fournisseurs, mais comme co-concepteurs du pouvoir. Les pouvoirs régaliens (sécurité, données, surveillance, défense) exploitent les technologies développées par le secteur privé, mais aussi les narratives, la capture d’attention, la structuration de l’information. (LES ANNALES DES MINES)
La démocratie se trouve alors mise à l’épreuve. Selon Mhalla, elle se vide de sa substance quand la légitimité ne repose pas sur un mandat électif ou des débats publics ouverts, mais sur la capacité technique, organisée, et sur les rendements des infrastructures technologiques. L’attention, la vérité, la visibilité — tous ces éléments deviennent des biens technologiques, conditionnés par les algorithmes, les données, les plateformes. (Le Point.fr)
Les risques associés
Parmi les risques identifiés par Asma Mhalla et d’autres analystes, on peut citer :
- La concentration de pouvoir entre les mains de quelques acteurs privés, avec peu de redevabilité démocratique.
- La dilution de la vérité (désinformation, manipulation algorithmique).
- Les biais dans les données et les modèles d’IA, qui peuvent reproduire ou amplifier les inégalités sociales ou politiques.
- La surveillance, directe ou indirecte, de la population, au travers des infrastructures numériques et des usages privés ou publics.
- Le risque d’une vision du futur dominée par les intérêts des techno-élites, excluant ou marginalisant ceux qui ne correspondent pas à leur modèle (géographique, social, idéologique). (LES ANNALES DES MINES)
Des exemples concrets
- Le développement d’IA formée sur des données filtrées selon certaines perspectives idéologiques. Par exemple, l’IA en Chine exclut les contenus critiques du gouvernement, ce qui façonne ce que les utilisateurs peuvent voir ou penser. (LES ANNALES DES MINES)
- La création de modèles concurrents d’IA par Elon Musk, jugeant que certains modèles existants sont trop « woke » ou trop soumis à des normes politiques ou culturelles qu’il ne partage pas. (LES ANNALES DES MINES)
- Les ambitions spatiales ou d’extension humaniste (colonisation de Mars, prolongement de la vie, etc.) qui, au-delà du défi scientifique, impliquent une projection de pouvoir idéologique et technique dans des domaines jusque-là peu gouvernés.
Voies de résistance et perspectives démocratiques
Repolitiser la technologie signifie, pour Mhalla comme pour d’autres chercheurs, remettre au cœur de l’agenda public les questions de gouvernance, de transparence, de responsabilité. Quelques pistes possibles :
- Régulation démocratique des infrastructures numériques : lois sur l’IA, protection des données, transparence des algorithmes, audits indépendants.
- Renforcement de la souveraineté technologique : les États, les collectivités territoriales doivent développer leurs propres capacités, pour ne pas dépendre exclusivement des géants privés.
- Participation citoyenne aux décisions technologiques : consultation, débat public, encadrement éthique, inclusion des voix marginalisées.
- Éducation critique au numérique : faire en sorte que les utilisateurs comprennent les effets politiques, idéologiques des technologies qu’ils utilisent.
Conclusion
Nous sommes entrés dans une ère où la technologie ne se contente pas d’être un levier, mais devient mode de gouvernance. Ceux qui codent les algorithmes, construisent les infrastructures, entraînent les modèles, ne dessinent pas seulement des produits, mais des futurs possibles — certains inclusifs, d’autres exclusifs. Reconnaître ce pouvoir technologique, comprendre ses idéologies sous-jacentes, et organiser des contre-pouvoirs démocratiques sont des étapes essentielles si l’on veut que le futur demeure un champ ouvert à toutes et tous, non l’apanage d’une minorité.
Pour aller plus loin : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50-du-week-end/l-invite-de-7h50-du-we-du-samedi-20-septembre-2025-2329773
Partager cet article:
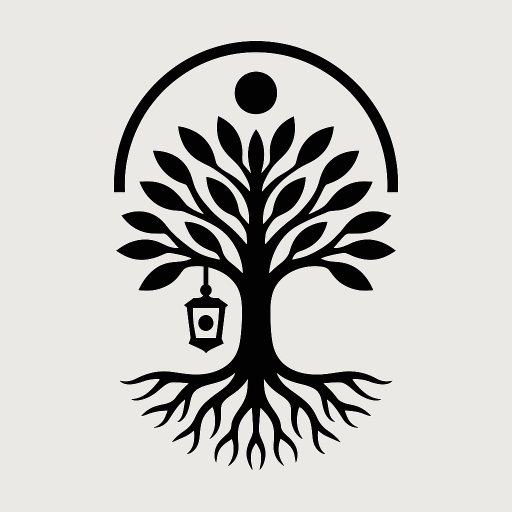


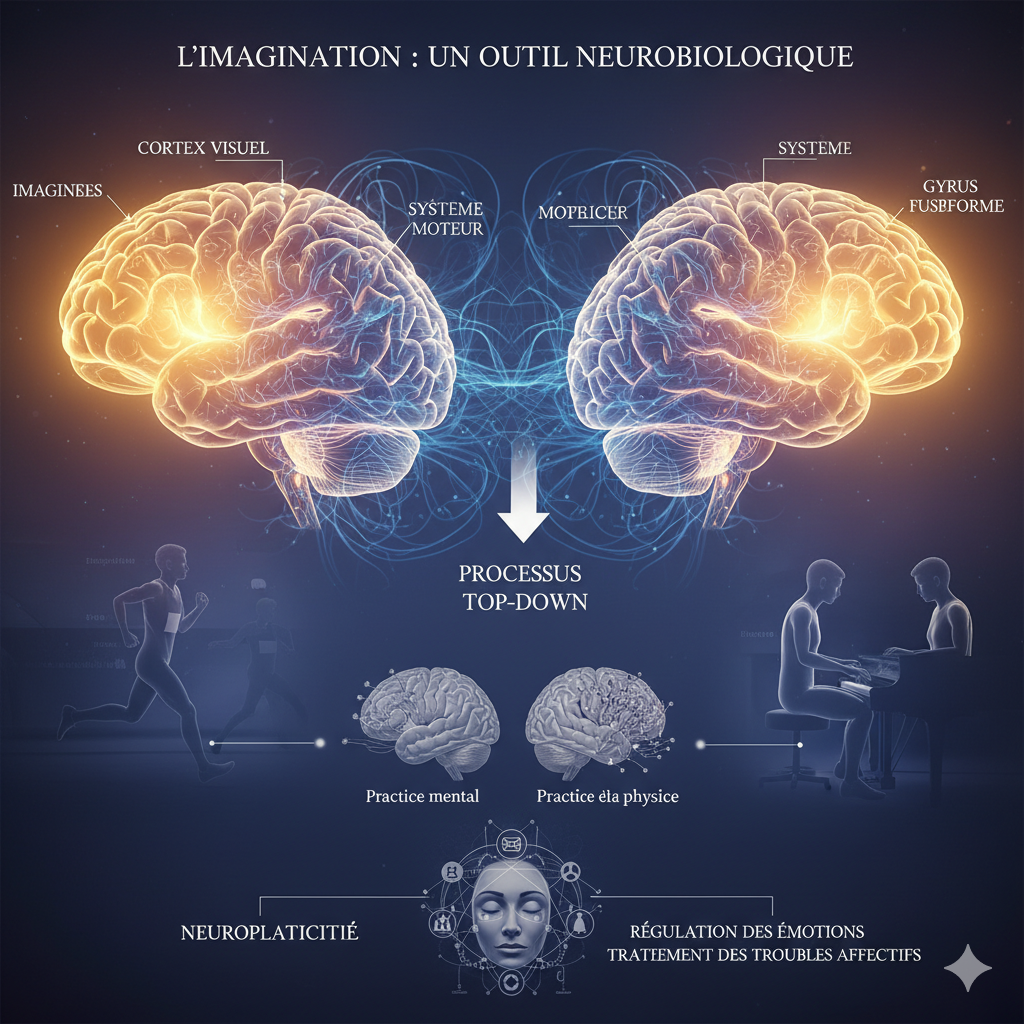

Laisser un commentaire